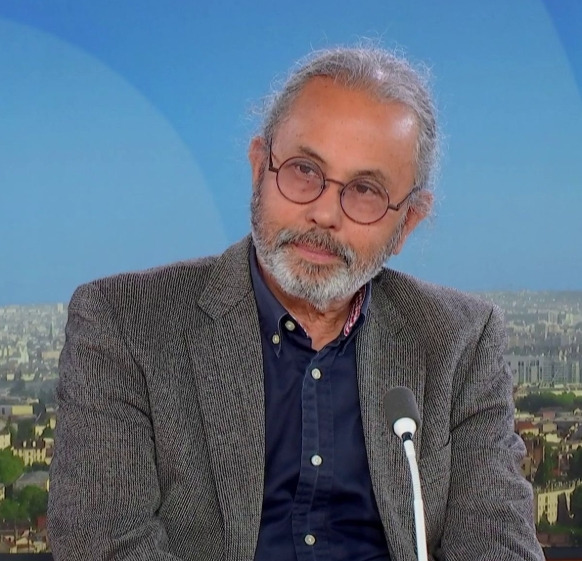
Kateb Yacine, l’homme aux mille voix
Dans un café enfumé de la Casbah, il riait fort, une cigarette coincée entre les doigts. La table était envahie de papiers, de carnets griffonnés à la hâte. On parlait politique, on parlait théâtre, on parlait du peuple qui s’entassait dans les bus bondés, de l’Algérie qui s’inventait chaque jour sous les gravats de la colonisation. Kateb Yacine, silhouette nerveuse, yeux brûlants, tenait le centre de la conversation. Il n’était pas encore ce « mythe » que l’on cite sans le lire, mais déjà une voix qui bousculait.
Le séisme
Nedjma. Quand son premier roman parut, ce fut comme si un coup de tonnerre avait traversé le ciel littéraire. Nedjma n’avait rien d’un récit linéaire. C’était une polyphonie de douleurs et de désirs, une mosaïque où l’Histoire se confondait avec la chair d’une femme insaisissable. Aragon, vieux lion des lettres françaises, s’en émerveilla aussitôt et proclama la naissance d’un écrivain d’une trempe rare. Dans les cafés du Caire, on en parlait comme d’un livre frère de Faulkner. À Damas, à Beyrouth, les jeunes écrivains lisaient ses phrases comme des manifestes.
Mais ce succès n’avait rien de facile. Le manuscrit avait connu les refus, les humiliations, les soupirs des éditeurs qui le trouvaient « obscur ». Lui s’en amusait : « La clarté, disait-il, est le luxe des colonisateurs. Nous, nous avons les labyrinthes. »
Le poète qui se faisait dramaturge
Le roman n’était qu’une porte. L’autre scène, plus vaste, plus explosive, était celle du théâtre. Le Cadavre encerclé, Le Cercle des représailles, Le Sans-culotte : autant de pièces qui n’étaient pas faites pour bercer le spectateur, mais pour l’assaillir, le contraindre à prendre parti. Jean-Marie Serreau parlait de « perles rares » ; Antoine Vitez d’« un génie ». Mais Kateb Yacine, lui, voulait que ses mots descendent dans la rue, qu’ils soient dits devant les ouvriers, les émigrés, les sans-grade.
Il mélangeait les registres comme un musicien de jazz : une tirade digne d’Eschyle se frottait à une chanson populaire, un éclat de rire grotesque interrompait une lamentation tragique. Le spectateur sortait ébranlé de la salle, parfois dérouté, toujours habité.
L’adolescent rebelle
On oublie qu’avant d’être écrivain, il fut prisonnier. Mai 1945 : les rues de Sétif s’embrasent, les chars écrasent les manifestations. Lui, à seize ans, connaît déjà les barreaux. À dix-sept, il se tient à Paris, en conférence, et parle de l’Émir Abdelkader et de l’indépendance. Qui, à cet âge, osait un tel défi ? Personne ou presque.
Son engagement fut précoce, irréversible. Il créa un parti éphémère, rejoignit le MTLD, fit des tournées de conférences. Mais toujours, en lui, brûlait la conviction que l’indépendance se gagnerait aussi par les mots. Alors il s’attaqua à la langue française, cette langue de l’oppresseur qu’il détourna en arme de libération. « Je la prends comme on vole un fusil », disait-il.
L’homme insaisissable
Kateb Yacine n’était jamais là où on l’attendait. Certains voulaient en faire une idole anticoloniale, d’autres le soupçonnaient de mépriser l’arabe ou l’islam. Erreurs grossières : il ne rejetait aucune langue, il refusait seulement leur instrumentalisation. Il voyait dans la fossilisation de la pensée un danger plus grand que la censure.
Il se méfiait des prix, des honneurs, des institutions. Nedjma n’obtint aucune récompense, et tant mieux : il n’écrivait pas pour les salons mais pour la vérité nue. Dans les années 1970, il multiplia les expériences théâtrales populaires, mêlant conteurs, ouvriers, acteurs amateurs. Il cherchait le spectateur ordinaire, pas le bourgeois cultivé.
L’autre Kateb, le journaliste
Dans l’ombre de ses romans et de ses pièces, un autre visage se dessine : celui du journaliste. Chroniques, enquêtes, reportages : des dizaines de textes éparpillés, brûlants, parfois inédits. Peu les lisent, presque personne ne les enseigne. Et pourtant, on y retrouve sa fulgurance, son humour, son sens aigu de l’injustice.
Le départ et la légende
Quand il mourut, en 1989, son cercueil fut posé aux côtés de celui de son cousin Mustapha, grand metteur en scène, qui s’éteignit le même jour. Deux destins frères, deux artistes liés jusque dans la mort. Dans l’aéroport, deux cercueils côte à côte : image d’une tragédie qui ressemblait à son théâtre.
Depuis, on a tissé mille légendes. On cite son nom, on le convoque, on l’instrumentalise. Mais on le lit trop peu. Nedjma, chef-d’œuvre mythifié, est souvent évoqué comme une énigme plus que comme un texte. Lui-même disait que beaucoup parlaient de son livre sans jamais l’avoir ouvert.
Kateb aujourd’hui
Reste l’essentiel : des mots qui ne vieillissent pas. Des voix, des fragments, des personnages qui traversent le temps. Lire Kateb, c’est accepter le désordre, le vertige, la densité. C’est entrer dans une littérature qui refuse la facilité, qui met le lecteur au travail, comme la liberté met le citoyen au défi.
Il n’était pas un écrivain de salon, mais un poète debout. Il savait qu’on ne change pas le monde par des phrases sages, mais par des phrases explosives. Voilà pourquoi, longtemps encore, Kateb Yacine nous accompagnera : parce qu’il fut le poète d’une liberté intraitable, un insurgé des mots, un veilleur pour les peuples.
Kamel Bencheikh
1. Lorsque tu es sur le site internet, clique sur les 3 petits points présents en haut et à droite de l’écran
2. Appuie sur « Ajouter à l’écran d’accueil ».
Et voilà, tu as maintenant RadioAzul.International au bout des doigts,
Bonne Écoute!
1. Lorsque tu es sur RadioAzul.international, clique sur l’icône "Partager" qui est en bas de l’écran de ton appareil.
2. Défile vers le bas la liste des actions et clique sur “Ajouter sur l’écran d’accueil”
3. Clique sur le bouton “Ajouter” situé en haut à droite de ton écran
Et voilà, tu as maintenant RadioAzul.International au bout des doigts,
Bonne écoute!