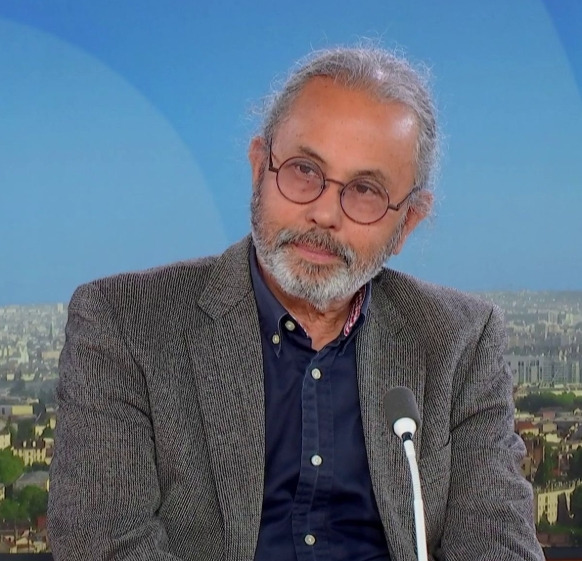
Les écrivains guetteurs de frontière.
Il y a des écrivains qui marchent au bord du gouffre. Non par goût du vertige, mais parce que
la vérité, aujourd’hui, ne se dit qu’à cet endroit — là où la parole risque sa peau.
Ce sont des guetteurs de frontière, des funambules entre la peur et la liberté. Ils savent que
chaque mot peut être un cri, une cible, une arme. Ils écrivent pourtant. Parce qu’ils savent
aussi qu’un mot juste peut être plus fort qu’une armée.
Assia Djebar fut l’une d’entre eux. Elle écrivit en français pour dire l’arabe qu’on lui avait
interdit. Sa langue, elle la porta comme une cicatrice lumineuse. Entre deux mondes, elle fit
du féminin et de la mémoire les armes d’une reconquête. Chez elle, écrire, c’était déjà
désobéir : désobéir aux traditions qui enferment, aux patriarcats qui bâillonnent, aux pouvoirs
qui étouffent.
Kateb Yacine aussi, l’insoumis des commencements, parla du français comme d’un « butin de
guerre ». Dans son œuvre, la langue coloniale devenait celle de la liberté retrouvée, le lieu
paradoxal où se réinventait l’Algérie déchirée. Il savait que la littérature n’est pas une
consolation, mais une révolte.
Et puis il y eut Rushdie — celui qui refusa de se taire. Les Versets sataniques lui valurent la
haine des fanatiques et la fatwa d’un régime entier. Depuis, il écrit debout, meurtri, survivant.
Il a compris avant tous que l’écrivain libre est un hérétique dans un monde redevenu
théocratique. Que publier un roman peut encore, en 2025, valoir une condamnation à mort.
Rushdie incarne cette ligne de feu où la littérature se mêle à la vie nue, où le verbe devient
résistance.
Boualem Sansal, lui, continue ce combat depuis l’Algérie des interdits et des silences. Ses
livres, d’une lucidité implacable, ouvrent les yeux d’un pays qui ne veut pas voir. Il parle du
fanatisme, du mensonge, de l’hypocrisie collective — et pour cela, il paie le prix de
l’isolement. Sa plume est une sentinelle : elle ne protège pas, elle avertit. Elle n’endort pas,
elle réveille. Chez Sansal, la peur n’est jamais une raison de se taire : c’est au contraire une
preuve que l’on touche juste.
Charb, enfin. Charb le dessinateur, l’écrivain malgré lui, l’homme debout. Jusqu’à la dernière
minute, il crut à la force du rire, à la liberté absolue du trait. Il savait le danger. Il le regardait
en face. Et c’est le rire qui lui coûta la vie, ce rire qui, depuis Voltaire, est la forme la plus
éclatante de la liberté française. Charb ne voulait pas mourir en martyr : il voulait continuer à
rire, à dessiner, à dire non.
De Rushdie à Sansal, de Charb à Djebar, s’écrit une même lignée : celle des écrivains de la
frontière. Ce sont les gardiens du verbe, ceux qui tiennent encore la ligne de crête entre la
servitude et la parole. Ils savent que la peur est le début de toute censure, et que celui qui
accepte de se taire pour survivre a déjà perdu plus que la vie : il a perdu le sens.
Écrire, aujourd’hui, c’est affronter le monde défiguré. C’est parler quand tout pousse à se
taire, c’est nommer l’innommable, c’est refuser la langue de bois, la langue morte, la langue
des pouvoirs. Écrire, c’est croire encore à la puissance du mot juste dans le vacarme des
mensonges.
Et c’est pourquoi ces écrivains — qu’ils soient d’Algérie, de France, d’Inde ou d’ailleurs —
forment une même fraternité invisible. Ils ne partagent ni passeport ni dogme, mais un même
serment : ne pas céder. Ils sont les héritiers de la phrase de Camus : « Mal nommer les choses,
c’est ajouter au malheur du monde. »
Alors, ils nomment. Malgré la peur, malgré la haine, malgré la solitude.
Leurs livres sont des refuges et des armes, des lieux où la conscience s’adosse pour ne pas
fléchir. Ils rappellent que la littérature n’est pas un divertissement, mais une forme de veille.
Et qu’un écrivain, s’il ne sert pas la vérité, finit toujours par servir la servitude.
1. Lorsque tu es sur le site internet, clique sur les 3 petits points présents en haut et à droite de l’écran
2. Appuie sur « Ajouter à l’écran d’accueil ».
Et voilà, tu as maintenant RadioAzul.International au bout des doigts,
Bonne Écoute!
1. Lorsque tu es sur RadioAzul.international, clique sur l’icône "Partager" qui est en bas de l’écran de ton appareil.
2. Défile vers le bas la liste des actions et clique sur “Ajouter sur l’écran d’accueil”
3. Clique sur le bouton “Ajouter” situé en haut à droite de ton écran
Et voilà, tu as maintenant RadioAzul.International au bout des doigts,
Bonne écoute!